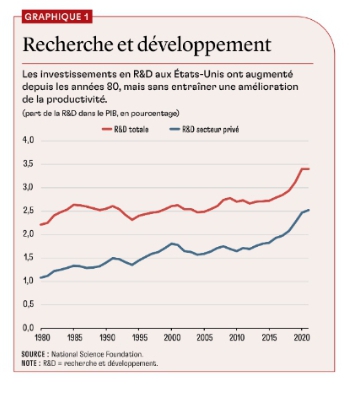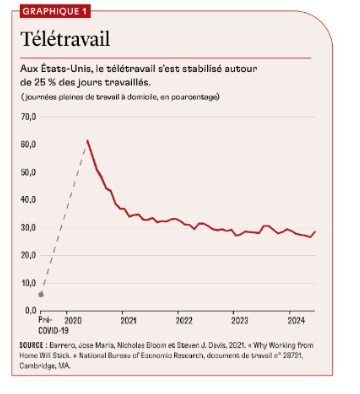Nous devons placer notre espoir dans le multilatéralisme (Gordon Brown)

Ce n’est qu’en œuvrant de concert que les pays pourront éviter la fragmentation et l’intensification des crises
« Ceux qui ne se tournent que vers le passé ou vers le présent sont certains de manquer l’avenir. » Ces mots prononcés par le président John F. Kennedy il y a 60 ans sont de nouveau chargés d’actualité. Chaque année qui passe expose un peu plus les failles de notre paradigme économique suranné et le besoin évident de changement.
Qu’il s’agisse du changement climatique ou de la poussée des menaces informatiques, les défis d’ampleur mondiale qui appellent des solutions à la même échelle sont omniprésents. Dans le même temps, nous assistons à l’effondrement des trois piliers du système mondial post-guerre froide : l’unipolarité, l’hypermondialisation et l’économie néolibérale. Ces changements profonds font le terreau d’une nouvelle vague de nationalisme populiste incarné par les mouvements de type « America First », « Russia First », « India First », « China First » et bien souvent « mon pays seul avant tout » qui apparaissent à travers le monde.
D’abord, notre monde unipolaire est en train de céder la place à un monde multipolaire — non pas un monde où plusieurs États sont de puissance équivalente, mais plutôt un monde caractérisé par de multiples centres de pouvoir. Il y a vingt ans, le président Poutine aurait-il envahi l’Ukraine ? Un Premier ministre israélien aurait-il tenu aussi longtemps en ignorant l’avis du président des États-Unis ? Les dirigeants arabes auraient-ils refusé de rencontrer un président des États-Unis en déplacement au Moyen-Orient ?
Il y a aujourd’hui des pays qui, libérés de ce qu’ils voyaient comme un carcan unipolaire, ont le sentiment qu’ils peuvent se permettre de miser sur plusieurs chevaux, se garder de prendre parti, et jouer les arbitres. Cela s’est manifesté de manière spectaculaire lorsque la moitié du monde, essentiellement des pays non occidentaux, a refusé de soutenir l’Ukraine dans la guerre qui l’oppose à la Russie. À ce jour, seuls 45 pays appliquent des sanctions contre la Russie. Il paraît possible de choisir le non-alignement ou le multi-alignement et de jouer sur les désaccords entre les grandes puissances. Et comme le démontre le développement du groupe des BRIC, qui est passé de cinq à dix membres et devrait en accueillir d’autres prochainement, la tendance est aux liaisons opportunistes et potentiellement dangereuses.
Ensuite, nous sommes aussi en train de passer d’un monde néolibéral caractérisé par l’économie du libre-échange à un monde davantage mercantiliste, défini par le « friend-shoring » — l’économie d’affinité — des Américains, le « dérisquage » des Européens et l’« autosuffisance » des Chinois. Sur ce fond de montée du protectionnisme, les États interviennent bien plus dans la politique économique — ils ne se contentent pas d’augmenter les droits de douane, ils interdisent certaines importations, certaines exportations, certaines technologies ou certains investissements, et ils imposent des sanctions.
L’année dernière, près de 3 000 restrictions commerciales ont été imposées dans le monde. Selon le FMI, les pertes résultant de cette fragmentation accrue des échanges commerciaux pourraient représenter un coût à long terme de près de 7 % du PIB mondial, sans parler du ralentissement de la coopération sur des questions d’intérêt planétaire telles que la transition écologique et l’IA.
Un ordre mondial régi par la loi du plus fort
Enfin, nous sommes passés d’une hypermondialisation débridée à une mondialisation entourée de plus de contraintes, où il faut désormais tenir compte des questions de sécurité, des considérations environnementales et de l’équité. Les banques centrales ne sont plus les seuls maîtres du jeu, et le règne de la loi cède la place à la loi du plus fort. Cela ne signifie pas pour autant que la mondialisation s’inverse ou ralentisse, comme le démontre le développement du commerce de services dans le monde. Ce qui se passe, c’est que plus de 100 pays ont adopté une politique industrielle nationale, et que plus de 2 500 mesures protectionnistes ont été prises rien que l’année dernière.
Dans les politiques d’achat, le « au cas où » a remplacé le « juste à temps », l’accent étant mis désormais sur la résilience et la sécurité de l’approvisionnement plutôt que sur le prix. Des pays qui échangent avec la Chine mais souhaitent atténuer leur dépendance vis-à-vis d’un seul producteur adoptent une stratégie « Chine plus un », plus deux, plus trois, plus quatre, ou même plus cinq, et réorientent leurs commandes pour exportation vers le Viet Nam, le Bangladesh, le Mexique et d’autres pays.
Alors que l’on estime que la croissance mondiale se situera à 2,8 % à l’horizon 2030, soit nettement en dessous de la moyenne historique de 3,8 %, le FMI avertit dans ses Perspectives de l’économie mondiale que les années 2020 risquent d’être la pire décennie de l’histoire récente en la matière. La montée du protectionnisme ne fera que diminuer la croissance mondiale au moment où un accroissement de la coopération s’impose pour stimuler les échanges commerciaux et la prospérité. L’extrême pauvreté , censée être éradiquée à d’ici 2030 en vertu des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, touche actuellement quelque 700 millions de personnes. Au rythme actuel, 600 millions de personnes vivront encore dans la pauvreté en 2030.
Dans les années 30, autre période de repli, Winston Churchill disait des dirigeants qu’ils étaient « résolus à être irrésolus, inflexibles dans leur dérive, solidement fluides, tout puissamment impuissants ». De nos jours, la déception des populations à l’égard de leurs dirigeants trouve son reflet dans le nationalisme populiste : les électeurs attribuent leur sort à la mondialisation alors que la faute revient à notre incapacité à la gérer correctement.
La déception des populations à l’égard de leurs dirigeants trouve son reflet dans le nationalisme populiste : les électeurs attribuent leur sort à la mondialisation alors que la faute revient à notre incapacité à la gérer correctement.
Or les politiques qui attisent les tensions, les accords commerciaux et sécuritaires éphémères et les alliances de passage ne mèneront pas les pays très loin. Pour tous les continents, l’avenir économique passera plutôt par un système international stable. Fût-ce pour des raisons différentes, tous ont besoin d’un ordre multilatéral : l’Europe parce qu’elle dépend du commerce ; les pays en développement parce qu’ils ne pourront réaliser leur potentiel économique sans bénéficier d’un transfert de ressources depuis les pays développés ; les pays à revenu intermédiaire parce qu’ils ne veulent pas être forcés de choisir entre la Chine et les États-Unis — et la Chine elle-même ne pourra rejoindre les rangs des pays à revenu élevé sans un marché d’exportation porteur.
L’Amérique aussi bénéficiera d’un renforcement de l’ordre multilatéral. Les États-Unis ne se trouvent plus dans un monde unipolaire où ils pourraient espérer triompher par l’action unilatérale. Ils sont plutôt le chef de file évident d’un monde multipolaire qui progressera grâce aux institutions multilatérales qu’ils ont eux-mêmes créées.
Renforcer le multilatéralisme
L’Organisation mondiale du commerce devrait mettre à profit les compétences certaines de sa directrice générale, Ngozi Okonjo-Iweala, afin de résoudre les différends commerciaux par la conciliation, l’arbitrage et la négociation, en s’écartant de son système d’appel devant des juges, trop légaliste et désormais inopérant.
Dans le même temps, le FMI devrait renforcer son rôle de prévention et de résolution des crises. Sous le leadership fort de Kristalina Georgieva, il devrait mettre davantage l’accent sur son rôle crucial de système d’alerte précoce pour l’économie mondiale, mobiliser sa capacité de prêt de 1 000 milliards de dollars pour mieux assurer ses membres contre les chocs économiques, négocier un mécanisme de restructuration de la dette souveraine nettement amélioré, et tisser ainsi un filet de sécurité financier mondial plus englobant.
Avec 59,1 % des droits de vote détenus par des pays qui représentent 13,7 % de la population mondiale tandis que l’Inde et la Chine n’en ont que 9 % à elles deux, le FMI doit aussi réformer ses statuts.
La Banque mondiale doit quant à elle devenir, comme l’a proposé son dynamique nouveau président, Ajay Banga, une banque de biens publics mondiaux axée sur la gestion du capital humain et de l’environnement. Selon les estimations, les marchés émergents et les économies en développement, à l’exclusion de la Chine, auront besoin de 3 000 milliards de dollars par an d’ici à 2030 pour financer l’action climatique et la réalisation des ODD, dont 2 000 milliards devront être réunis au niveau national et 1 000 milliards devront être obtenus de sources extérieures.
Le rapport Summers–Singh du G20 propose une augmentation annuelle de 260 milliards de dollars de l’apport des banques multilatérales de développement. Afin de soutenir et de compléter cette démarche, il faudra mobiliser des mécanismes financiers novateurs, notamment le recours aux garanties pour écarter les risques liés à l’investissement privé et le faire passer à l’échelle supérieure. La Banque mondiale et les banques multilatérales de développement devront obtenir davantage de fonds de la part de leurs membres au moyen d’une augmentation de leurs fonds propres.
Le Groupe des Sept est trop restreint pour piloter l’économie mondiale : le Groupe des Vingt (G20) devrait donc jouer le rôle pour lequel il était prévu, celui d’un forum de premier plan pour la coopération économique mondiale. Pour y parvenir, il lui faudra, d’une part, devenir plus représentatif grâce à un système électif et, d’autre part, créer un secrétariat professionnel apte à assurer la continuité des politiques d’année en année.
Dans les temps difficiles, il est essentiel de conserver l’espoir. Le traité sur l’interdiction des essais nucléaires de Kennedy dans les années 60, la démarche de réduction des armes nucléaires de Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev dans les années 80, les efforts multinationaux de prévention de l’appauvrissement de la couche d’ozone dans les années 90, le sommet du G20 de 2009 axé sur la stabilisation de l’économie mondiale et, plus récemment, l’accord de Paris sur le climat sont autant de preuves du potentiel de coopération au niveau mondial. Mais la clef du succès sera un leadership visionnaire et la volonté de collaborer.
Deux voies s’offrent à nous : l’une mène vers la fragmentation du monde et l’intensification des crises ; l’autre, si nous œuvrons de concert, vers la prospérité, le progrès et l’espoir. Pour ma part, je choisis l’espoir.
Cet article est tiré d’un discours prononcé par l’auteur lors de la conférence sur la conduite du changement structurel organisée en avril 2024 par le PIIE et le FMI.