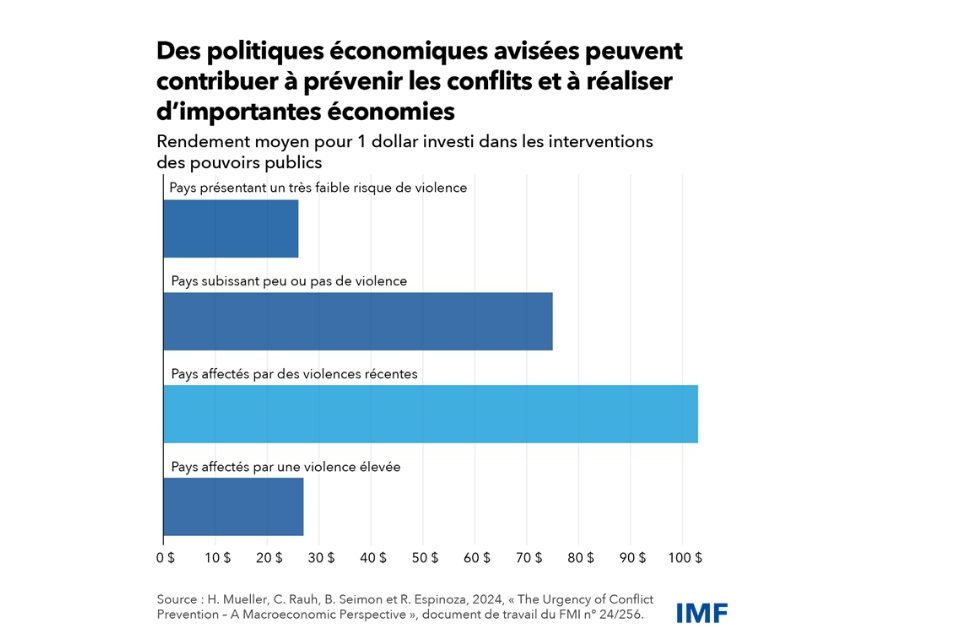Elle a le vert dans la peau, que ce soit avec l’AS Saint-Étienne, où elle défend les couleurs en Division 1 française, ou avec l’Algérie, où elle est devenue l’une des joueuses clés depuis ses débuts en 2018. À 29 ans, elle se prépare à vivre sa deuxième Coupe d’Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, après une première expérience au Ghana qui l’a marquée à vie. Alors âgée de 22 ans, Morgane n’avait pas pu éviter l’élimination prématurée avec son équipe dans un groupe extrêmement relevé, comprenant des équipes comme le Cameroun, le Ghana et le Mali.
Ce premier contact avec le football africain a été difficile, mais il lui a offert des enseignements précieux sur les exigences de cette compétition, les différents styles de jeu et l’atmosphère unique de la CAN Féminine.
Aujourd’hui, avec l’expérience et les années de travail acharné, elle aborde cette deuxième édition avec une vision plus claire et une confiance nouvelle, prête à faire profiter l’équipe de tout ce qu’elle a appris depuis.
Dans une interview accordée à CAFOnline.com, Morgane Belkhiter se confie sur les progrès réalisés par l’équipe depuis son dernier tournoi, notamment grâce à l’arrivée de l’entraîneur Farid Benstiti. Sous sa direction, l’Algérie a su créer une identité de jeu unique, mêlant un équilibre entre puissance physique et technique. Avec un groupe soudé et une dynamique de compétitivité accrue, les Vertes se sentent prêtes à affronter les cadors du Groupe B, notamment le Nigeria, le Botswana et la Tunisie.
Avec une équipe jeune, mais ambitieuse, la défenseure est optimiste sur les chances de l’Algérie, rêvant d’aller le plus loin possible et de décrocher un titre continental, un objectif qu’elle considère comme l’ultime consécration.
CAFOnline.com : L’Algérie évoluera dans le groupe B aux côtés du Nigeria, de la Tunisie et du Botswana. Quelles sont vos impressions ?
Nous sommes dans une poule très relevée, notamment avec le Nigeria, l’une des plus grandes nations du football africain. Nous les avons récemment affrontées en amical, un match qui s’est soldé par une défaite 4-1. La Tunisie fait également partie du groupe ; nous les avions rencontrées l’an dernier dans un match qui s’était terminé sur un score de 2-2. Certes, leur effectif a évolué depuis, mais cela reste une équipe de grande qualité, avec de nombreuses joueuses évoluant en France. Quant au Botswana, c’est une formation que nous connaissons moins. Personnellement, je ne les ai jamais affrontées. C’est un groupe qui réunit de belles équipes et beaucoup de talent, ce qui promet des rencontres passionnantes.
La dernière participation de l’Algérie à la CAN féminine remonte à 2018, au Ghana, avec une élimination au premier tour. Quels souvenirs en gardez-vous ? Et surtout, quelles leçons en avez-vous tirées ?
2018, cela remonte à loin… J’avais 22 ans et c’était ma première sélection. Nous avons été éliminées dès le premier tour, dans une poule très relevée, qualifiée de « groupe de la mort », avec le Cameroun, le Ghana et le Mali. Pour moi, en tant que jeune joueuse, cette première expérience a été très difficile, mais elle m’a aussi beaucoup appris. Jouer en Afrique, c’est particulier. On découvre un autre football, un autre environnement.
Avec le recul, je réalise combien cette CAN m’a fait grandir. Aujourd’hui, je connais mieux cette compétition, les styles de jeu, l’atmosphère. J’espère pouvoir disputer cette deuxième CAN en juillet et y mettre à profit tout ce que j’ai appris. Le tournoi se déroulera au Maroc, ce qui signifie des conditions différentes de celles du Ghana, mais nous savons à quoi nous attendre : une compétition exigeante, une ambiance survoltée, des conditions climatiques parfois difficiles. C’était une belle expérience et j’ai hâte d’en vivre une nouvelle avec l’Algérie.
Comment avez-vous vécu ces sept années sans participer à une CAN féminine ?
C’était très, très long. En 2022, nous avons affronté l’Afrique du Sud au second tour des qualifications. Nous avons perdu 2-0 à l’aller et fait match nul au retour. Nous avons nourri beaucoup de regrets, car nous avions les moyens de renverser la situation à domicile. Cette élimination a été douloureuse, car nous étions si proches d’une qualification.
Sept ans, c’est une éternité. En Afrique, les compétitions féminines sont rares : il y a la CAN et les qualifications pour les Jeux Olympiques, mais c’est à peu près tout. Aujourd’hui, nous avons enfin l’opportunité de jouer cette CAN au Maroc, et nous avons hâte d’y être.
D’après vous, en quoi l’équipe a-t-elle progressé ?
L’équipe a beaucoup évolué sous la direction du coach Farid Benstiti, un grand nom du football féminin. Depuis son arrivée, il a intégré de nombreuses joueuses au groupe et apporté une approche différente. Cela fait trois ans qu’il est en place, et on ressent vraiment son impact.
Le style de jeu africain est très différent de celui que l’on trouve en D1 ou D2 en France. Il n’est pas facile d’intégrer de nouvelles joueuses à ce contexte, mais aujourd’hui, l’Algérie est une équipe qui suscite du respect. Nous avons notre propre identité de jeu, distincte de celle du Nigeria ou de l’Afrique du Sud, qui évoluent dans un style plus direct. Comparé au Maroc ou à la Tunisie, qui jouent de manière plus technique, nous avons notre propre approche. L’Algérie peut devenir une grande nation du football féminin africain, j’en suis convaincue.
Quel est l’état d’esprit avant cette CAN féminine ?
Depuis notre qualification, nous sommes impatientes. À chaque stage, de nouvelles joueuses rejoignent le groupe, ce qui renforce la dynamique et la compétitivité. L’ambiance est excellente, nous avons un collectif soudé. Nous avons toutes hâte d’arriver au Maroc, de disputer notre premier match et de vivre pleinement cette compétition. Une CAN, ce n’est pas une expérience que l’on vit tous les jours, alors nous comptons en profiter à fond.
Aujourd’hui, vous êtes une cadre de l’équipe. Comment votre rôle a-t-il évolué au sein des Vertes ?
Lorsque j’ai intégré la sélection, j’avais 22 ans et je disputais ma première CAN. Depuis, les années ont passé, j’ai accumulé de l’expérience, disputé des matchs importants, et cela m’a permis de grandir en tant que joueuse. Aujourd’hui, je fais partie des cadres de l’équipe nationale, et j’en suis fière. Ce statut implique des responsabilités, ce n’est pas toujours simple, mais je pense avoir les épaules pour assumer ce rôle avec fierté.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans cette nouvelle génération de joueuses algériennes ?
Avant tout, l’ambiance au sein du groupe est exceptionnelle. Nous avons une vraie cohésion, un état d’esprit collectif fort. Chacune sait pourquoi elle est là et nous partageons toutes un même objectif.
Avec les autres cadres, nous avons mis en place certaines règles pour maintenir notre concentration et préserver notre motivation. Nous savons que la CAN est une compétition exigeante et nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes. Le niveau est aussi très élevé, ce qui rend chaque entraînement et chaque match intéressant. Chaque rassemblement est un moment que j’attends avec impatience, tant pour retrouver mes coéquipières que pour continuer à progresser ensemble.
En tant que défenseure, comment analysez-vous l’évolution du football féminin en Afrique, notamment en termes de tactique défensive ?
Le football féminin évolue rapidement, notamment grâce aux analyses vidéo, qui nous permettent de mieux comprendre nos erreurs et de les corriger. De plus en plus de joueuses talentueuses rejoignent les équipes nationales, ce qui élève le niveau général. L’approche tactique devient plus pointue, et nous devons sans cesse nous adapter pour rester compétitives.
Quel serait votre rêve ultime avec l’équipe nationale algérienne ?
Mon rêve serait de remporter un titre, de gagner la CAN. Ce serait une immense fierté et un immense honneur. Je pense que c’est le rêve de toute joueuse qui porte les couleurs de son pays. Nous allons tout donner pour atteindre cet objectif.