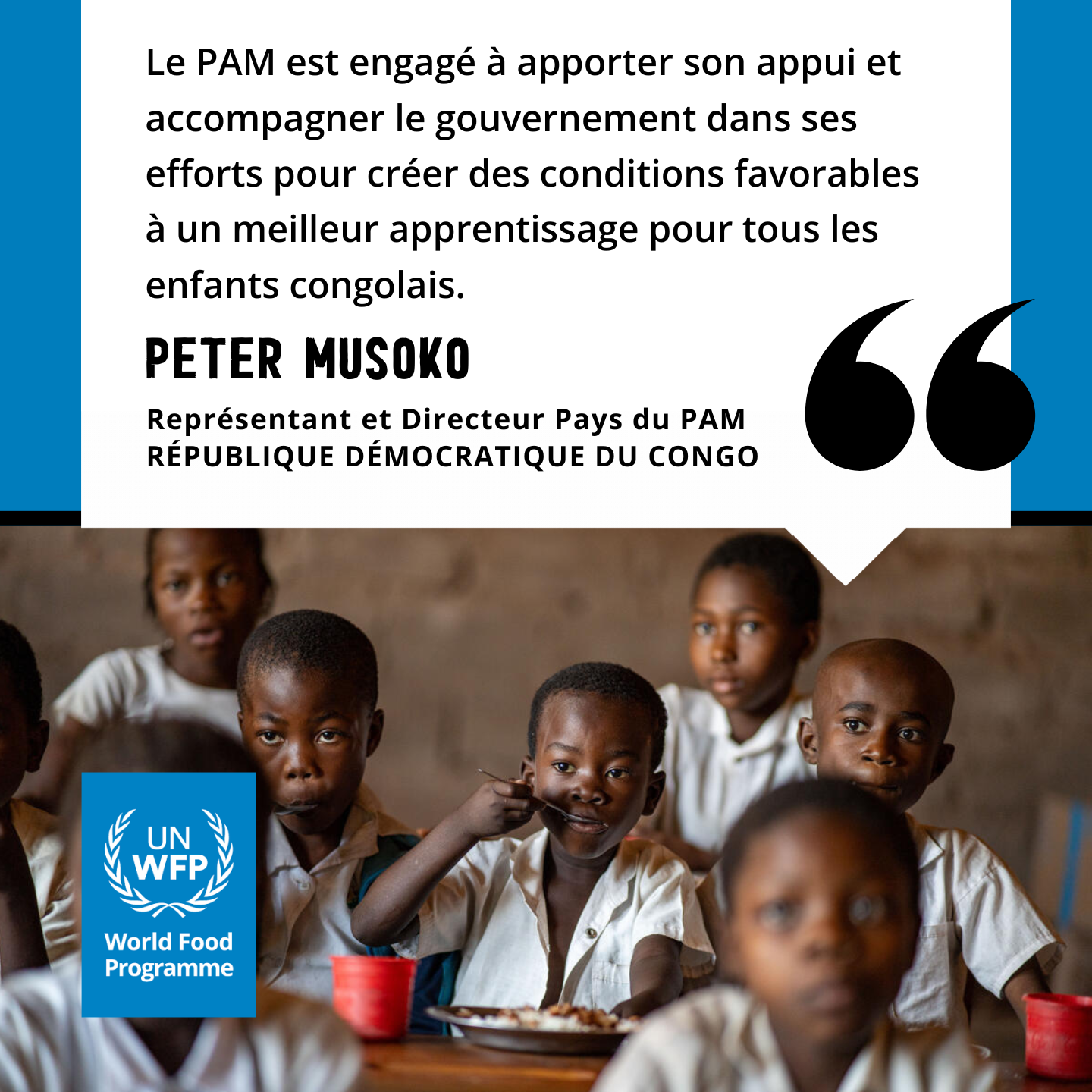Liberté et égalité: CEDHUC renforce les capacités des membres de la CNDH et de la société civile

Le Centre d’expertise en droit humains et criminologie (CEDHUC) organise simultanément depuis hier lundi, un atelier de renforcement des capacités des défenseurs des droits de l’homme, membres de la société civile d’un côté, et des membres de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) de l’autre côté, dans le cadre de son projet « Liberté et égalité pour tous ».
Cette formation de deux jours, soit du 16 au 17 décembre 2024, vise à renforcer les capacités des participants sur les notions des droits de l’homme afin qu’ils deviennent de plus en plus responsables et réceptifs aux droits des populations clés, et défendent leurs droits et les normes sociales.
Selon Me Altesse Altesse Mukundji Ngiama, avocat de CEDHUC, ces formations sont organisées dans le cadre de la campagne UNFE, financées par le bureau du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) RDC.
« Aujourd’hui, nous avons une même formation pour deux cibles différentes. D’un côté, ce sont les membres de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). Et de l’autre, il s’agit des activistes des droits humains, disons la société civile. Alors pour les deux cibles, il est question de mettre à leur disposition tous les outils possibles afin de leur permettre d’être capable sur le terrain. Et donc, nous les avons sensibilisés principalement sur les notions clés des droits humains et aussi présenter à nos bénéficiaires, notamment les personnes vivant avec le VIH, les personnes clés, leur faire comprendre que nous avons un grand travail à faire, et surtout en rapport avec le défi qui se présente devant nous sur les droits de personne. Nous leur avons demandé de faire leur travail avec les outils que nous avons mis à leur disposition », a-t-il souligné.
Outre le module sur les droits humains, sur l’agenda, peut-on lire, la notion sur la Santé sexuelle et reproductive a occupé une place de choix lors de cette première journée.
« Ces deux notions sont pour nous des outils permettant à tous ceux-là qui interviennent sur les droits humains d’être capables de faire bien leur travail en respectant la liberté et l’égalité principalement pour les Personnes Lgbi, et vivant avec le VIH », a fait savoir Me Altesse Mukundji Ngiama, visiblement très ému des échanges participatifs des activistes même s’il s’est dégagé le fait que certaines notions basiques des droits humains, quand bien-même qu’il y a des gens sur le terrain, ils n’avaient pas la maitrise voulue par rapport à ces notions. Cependant, souligne cet avocat Près la Cour d’appel de Kinshasa Matete, les échanges étaient participatifs mais aussi intéressants, et ont permis de comprendre et dégager certaines faiblesses et penser à les combler.
« J’ai beaucoup apprécié les thématiques sur les droits humains, précisément sur l’égalité entre les personnes, entre les êtres humains sans tenir compte de leur race, sexe ou encore nationalité et de leur orientation sexuelle…Mais aussi des violences, notamment sexuelles, d’harcèlement. C’est un très bon renforcement des capacités qui nous aidera à aller plus à sensibiliser, à mieux communiquer dans la communauté afin d’atténuer la stigmatisation et la discrimination. Et donc, je souhaite que ce genre d’atelier soit perpétué, parce que ca va aider les acteurs à bien travailler sur le terrain », s’est réjouie l’assistante administrative et chargée de communication de la Ligue nationale anti tuberculeuse et lépreuse du Congo (Lnac), Mme Jidi Sakandongo Liliane, participante à cette formation. Ils sont au total 50 participants, venus de plusieurs organisations de la société civile.
Après ces formations, l’objectif est de voir ces hommes et femmes de terrain, améliorer leur travail quotidien mais aussi assurer cette synergie avec le CEDHUC et la CNDH relativement à la loi récemment publiée par le Chef de l’Etat sur la collaboration avec la CNDH.
Bien avant cette formation, rappelons que le Centre d’expertise en droit humains et criminologie (CEDHUC) avait toujours dans le cadre de son Projet « Liberté et égalité pour tous », eu à organiser plusieurs autres formations à l’intention des magistrats et policiers.
Prince Yassa