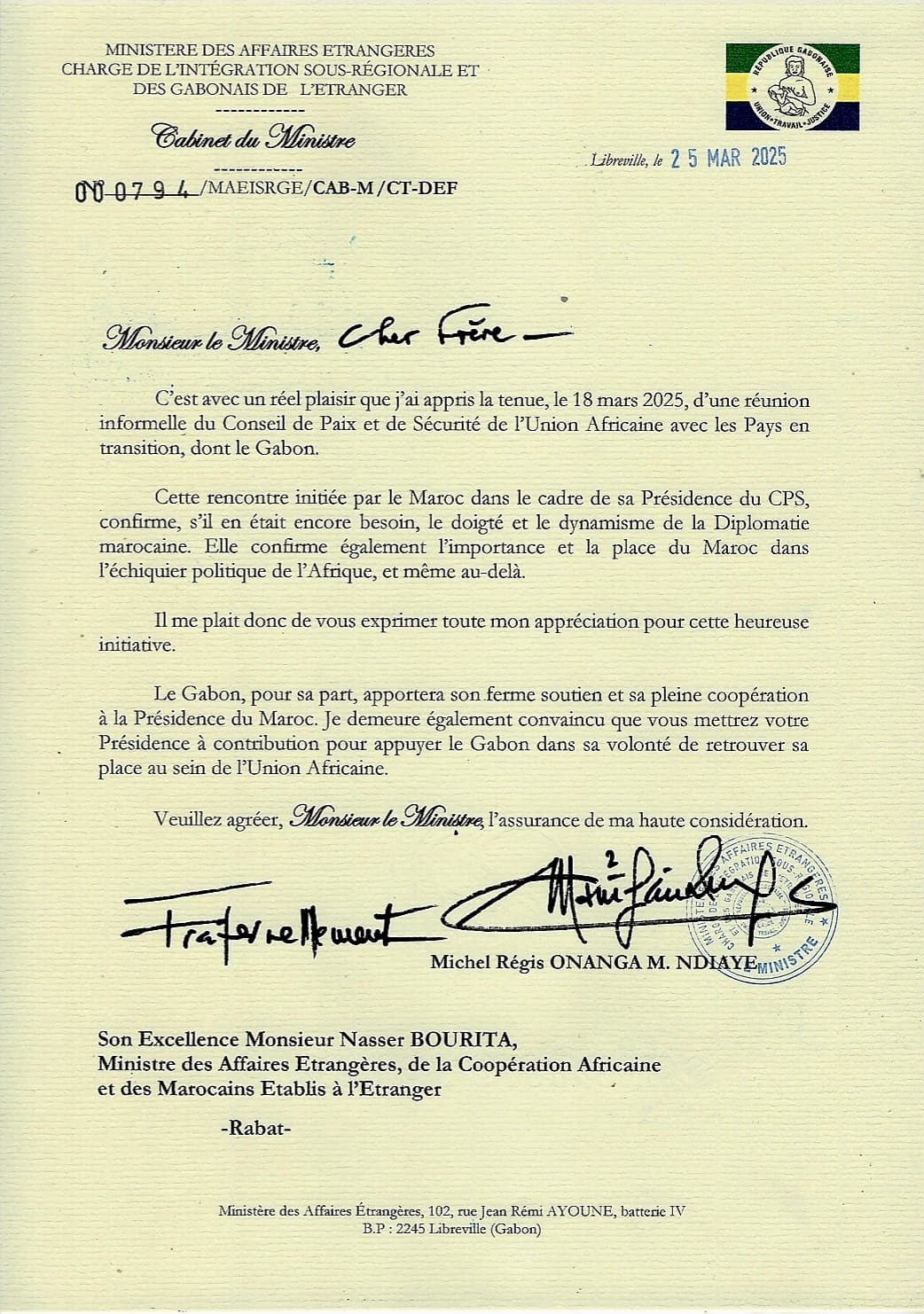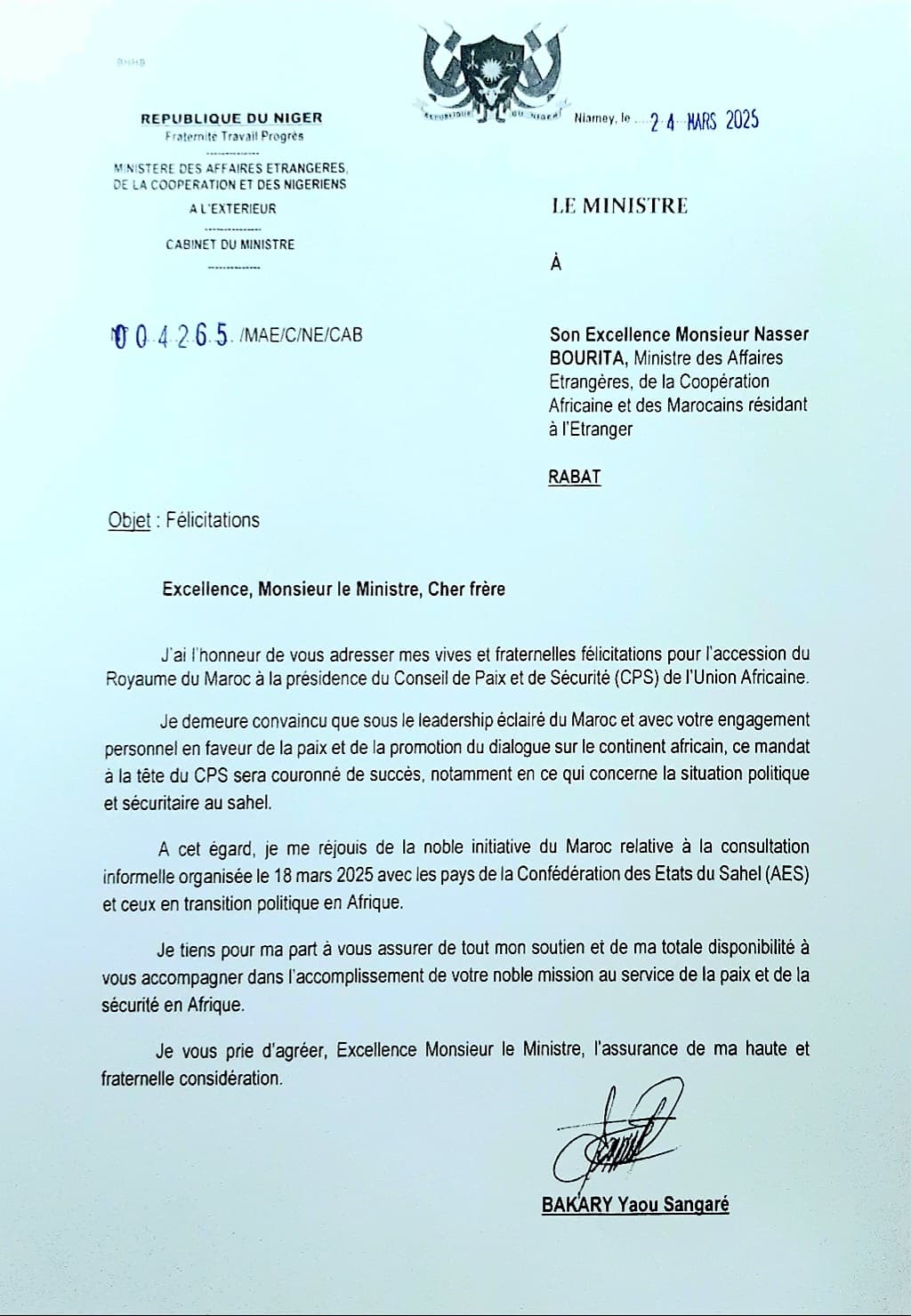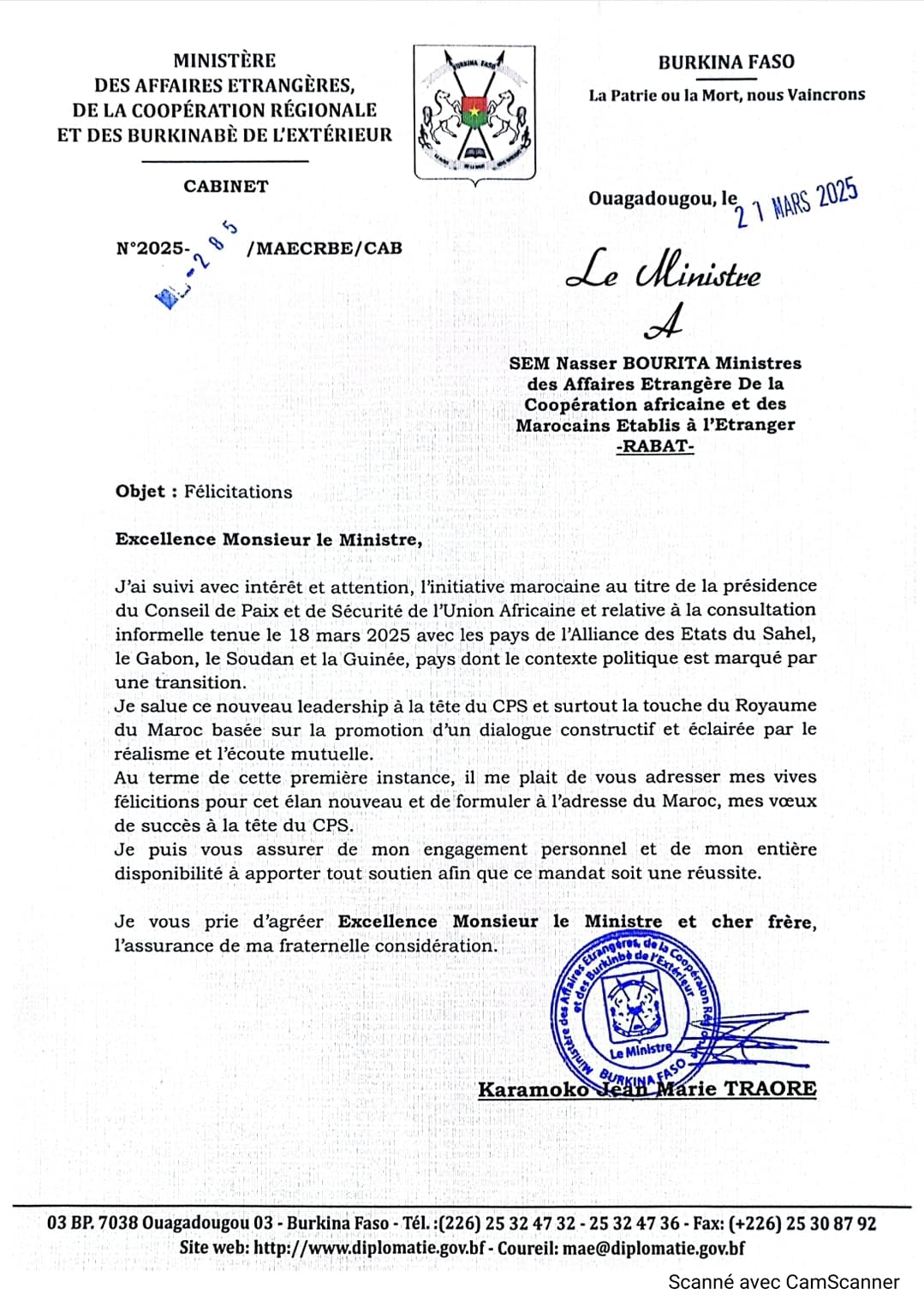(Note de l’éditeur : Cet article représente le point de vue de l’auteur Karim Badolo et pas nécessairement celui de CGTN.)
Le monde est entré dans une nouvelle période de turbulences et de changements. Certains pays occidentaux considèrent la Chine comme un concurrent stratégique majeur. Il faut, selon ces derniers, essayer de contenir le développement de la Chine par tous les moyens. Dans le même temps, un nouveau cycle de révolution scientifique et technologique et de transformation industrielle apporte de nouvelles façons de concevoir le développement. Il est en train de remodeler le paysage mondial de développement. L’incertitude, l’instabilité et l’imprévisibilité augmentent. Toutefois, ces impondérables apportent des opportunités et des défis sans précédent aux pays du monde entier.
La Chine continue inexorablement d’imprimer sa présence au monde à travers sa propre voie. Le processus de modernisation à la chinoise se poursuit à un rythme soutenu et accéléré grâce à des réformes politiques structurées pour qui irriguent tous les secteurs d’activités de nouvelles énergies porteuses d’innovation. Que faut-il entendre par développement de haute de qualité?
Le concept renvoie à un développement qui prend l’innovation comme le premier moteur du développement, la coordination comme une caractéristique endogène, le développement vert comme une forme universelle, l’ouverture comme la seule voie et le partage comme l’objectif fondamental. Lorsqu’il a dirigé l’élaboration du 14e plan quinquennal et celle des objectifs de la Vision 2035, le président chinois Xi Jinping a indiqué qu’un développement de haute qualité est plus qu’un simple slogan qui va au-delà du secteur économique. Lors de la cinquième session plénière du 19e Comité central du Parti communiste chinois, il a précisé que les domaines économique, social, culturel, écologique et autres doivent refléter les exigences d’un développement de haute qualité. Par développement de haute qualité, il faut entendre la construction d’un système industriel moderne, la protection de l’environnement écologique, le développement des œuvre sociales et la promotion d’une prospérité commune au profit de l’ensemble de la population. Le développement de haute qualité englobe tous les aspects du développement économique et social avec l’innovation comme leitmotiv.
Le monde est en pleine mutation et connaît des changements majeurs sans précédent induits par l’Internet, le big data, l’intelligence artificielle, etc. La nouvelle génération de technologies informatiques évolue chaque jour à une vitesse exponentielle. Un nouveau cycle de révolution scientifique et technologique et de transformation industrielle est en cours. Ce constat suppose la nécessité d’une adaptation pour être en phase avec les exigences d’une société aux besoins sans cesse croissants. Le développement de haute qualité implique l’idée que les facteurs de production traditionnels intègrent l’innovation comme norme. Désormais il est question de prendre davantage appui sur l’innovation de la science et de la technologie pour renforcer des milliers de secteurs d’activités. Il s’agit de promouvoir une économie en vue d’une amélioration qualitative, efficace et une croissance rationnelle.
L’économie chinoise est passée d’une phase de croissance rapide à celle de développement de haute qualité avec une relation entre la croissance économique et le développement économique. Il met plutôt l’accent sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la croissance économique. Si la croissance économique fait principalement référence à la croissance quantitative, le développement économique ne se rapporte pas seulement à l’augmentation du volume. Il prend en compte également de l’amélioration qualitative, l’équilibre entre le développement des régions orientale, centrale et occidentale. Il s’agit de travailler à réduire le taux entre la proportion de la population à haut revenu et celle de la population à faible revenu.
Quels résultats obtenus ?
De manière précise, le développement de haute qualité reflète non seulement l’efficience de l’activité économique d’un pays ou d’une région, le niveau de vie et la richesse de ses habitants et le pouvoir économique qu’il possède. A titre illustratif, le PIB par habitant de la Chine, qui était d’un équivalent de 6 301 dollars américains en 2012, est passé à 12 681 dollars en 2023. Cela a engendré la formation d’un groupe à moyen revenu avec une population de plus de 400 millions de personnes. A terme, le développement de haute qualité poursuit l’objectif d’un modèle économique rapide, social durable et inclusif.
La promotion des nouvelles énergies est une dimension importante du développement de haute qualité. A ce titre, le cas des véhicules à énergies nouvelles en Chine est très édifiant. En 2023, la production et la vente de véhicules à énergies nouvelles en Chine ont atteint respectivement 9,587 millions d’unités et 9,495 millions d’unités. Cela représente respectivement une augmentation de 35,8 % et de 37,9 % en glissement annuel.
Les parts de marché des véhicules à énergies nouvelles chinois représentent plus de 60 % du total mondial.
Le développement de haute qualité a littéralement transformé l’industrie manufacturière traditionnelle qui a profité de l’innovation scientifique et technologique pour s’inscrire dans la modernité. Ainsi 81 petites et moyennes entreprises sont devenues le premier groupe de sociétés cotées en bourse. Une autre plate-forme importante pour la mise en place d’un système d’innovation complet et adapté à l’innovation scientifique et technologique du système financier a été mise en place. Elle vise à servir les petites et moyennes entreprises innovantes, surtout spécialisées et nouvelles petites entreprises géantes.
Dans ce processus, le gouvernement central guide le marché des capitaux pour ouvrir des canaux de financement en faveur des petites et moyennes entreprises afin de réaliser un développement de haute qualité. On peut citer également le corridor d’innovation scientifique et technologique du G60 à 1 200 kilomètres au sud-est de la Bourse de Beijing. Afin de promouvoir un développement de haute qualité à partir de la pratique de base, elle est devenue une plate-forme importante pour la stratégie nationale de développement intégré du delta du fleuve Yangtsé.
L’autoroute Shanghai-Kunming dénommée G60 est aussi l’un des résultats éloquents du développement de haute qualité. La plupart des sections de cette autoroute qui passent par Shanghai se trouvent dans le district de Songjiang. En s’appuyant sur cette grande artère, Songjiang a créé une destination privilégiée pour les industries de haute technologie. Il a donné naissance à 2 052 nouvelles entreprises spécialisées et spéciales. Parmi elles, se trouvent 82 entreprises d’État, l’île des sciences de Hefei, la Vallée optique de Chine à Wuhan, et le Parc scientifique et technologique Zhigu de Chine à Chongqing.
Les gouvernements de différentes régions s’efforcent de créer des plate-formes d’innovation dynamiques. Les entreprises, en suivant la logique interne des chaînes d’innovation, industrielle, d’approvisionnement et de valeur, forment des clusters vifs.
En juillet 2024, le renforcement de la position principale des entreprises en matière d’innovation scientifique et technologique a été inscrit dans la « Décision » de la troisième session plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois.
A l’instar de bon nombre de provinces chinoises, le Hunan a promu une développement de haute qualité sans précédent. Ces dernières années, l’augmentation du nombre d’entreprises de haute technologie dans le Hunan a dépassé plus de 2 000 par an. L’innovation est un point d’attrait du Hunan. En 2023, le revenu disponible par habitant dans les localités urbaines et rurales du Hunan s’est élevé respectivement à 49 200 yuans et 20 900 yuans. L’Indice de développement vert se classe parmi les dix premiers du pays. Toujours en 2023, le volume total des importations et des exportations du Hunan a dépassé le cap des 110 milliards de dollars américains. En outre, la province a mis en place des médecins généralistes dans les cliniques de village et les centres de santé des cantons et la couverture complète des hôpitaux publics de deuxième classe au niveau du district. L’innovation, la coordination, le vert, l’ouverture et le partage constituent un ensemble indissociable qui participe à transformer qualitativement tous les secteurs d’activités dans cette province.
Les quatre plaques régionales que sont Changsha-Zhuzhou-Xiangtan, le lac Dongting, le sud et l’ouest du Hunan ont connu un développement coordonné et une nette amélioration du niveau d’équilibre entre les zones urbaines et rurales. En 2023, China Mobile a construit à Guiyang la première chaîne de puissance de calcul 400G au monde. Le transfert de données de Guiyang à Shenzhen ne prend que 10 millisecondes. Le Guizhou est aujourd’hui à l’avant-garde du développement de l’économie numérique. L’industrie du big data du Guizhou est partie de zéro en se frayant une nouvelle voie pour faire un bond en avant en matière de développement durable. Le désert de Tara dans le Qinghai était autrefois une terre aride. Aujourd’hui, les panneaux photovoltaïques forment une mer bleue. Les panneaux photovoltaïques sont fabriqués dans la zone de développement économique et technologique de Xining.
Le Xinjiang tire pleinement parti des avantages de ses propres ressources. La région autonome a planifié et construit une base nationale d’énergies propres à grande échelle. L’ampleur du développement des énergies renouvelables continue de s’étendre. La construction de bases éoliennes, de parcs photovoltaïques et d’autres projets avancent de manière ordonnée. Le Xinjiang a réalisé le développement rapide de programmes à grande échelle, intensifs et la généralisation des zones industrielles.
En un mot, le développement de haute qualité est inclusif d’autant plus qu’il prend en compte toutes les localités en tenant compte des spécificités de chacune. L’essentiel revient à trouver la voie d’un développement de qualité adaptée à la situation réelle de la région.
(Photo : VCG)